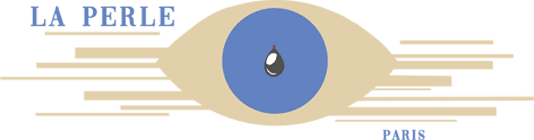L’urgence climatique était au coeur de ce Festival d’Avignon. Des pièces qui soufflent un vent de fraîcheur salutaire et réaffirment le rôle du théâtre en tant que laboratoire citoyen.

L’engagement écologique est en berne. Les questions environnementales prennent moins de place dans le débat public et le politique se désengage. Une lassitude qui est aussi le fait d’un contexte géopolitique particulièrement tendu. Face à l’annonce ce matin de méga-feux au Canada ou du grindadráp aux îles Féroé, dans quelles réserves émotives puiser pour réagir, lorsque celles-ci ont été siphonnées hier déjà à l’annonce d’un nouveau bombardement sur Gaza?
Cette surexposition à une actualité souvent désastreuse, instille en nous une forme d’apathie. Une impuissance à s’émouvoir. Chacun en vient alors à se créer ce que l’empereur et philosophe romain Marc Aurèle appelait, une « citadelle intérieure », imperméable aux troubles du dehors.
Eh bien, c’est précisément cette citadelle que le théâtre, dans un assaut salvateur, fait s’effondrer. Le théâtre, en tant qu’irrémédiable véhicule de l’émoi, dernier rempart avant l’indifférence. Dernier rempart avant de sombrer dans le monde de Solee, l’héroïne de La Faille, l’une des pièces qui a retenu notre attention. Écrite par Serge Kribus et mise en scène par Paul Pascot, elle raconte l’odyssée d’une jeune fille sensible sur une terre pourrissante où les émotions ont disparu…
Loin du sentiment d’élitisme et d’entre-soi qu’il dégage parfois, c’est donc un théâtre résolument tourné vers le réel que l’on a vu se déployer cette année au Festival d’Avignon. Après chaque représentation de Nourrir l’humanité c’est un métier, spectacle documentaire saisissant sur le drame en cours dans nos campagnes, son co-auteur, Charles Culot, organise un moment d’échange avec des intervenants du secteur associatif local.
Mais ces pièces vont plus loin. En plus de servir d’électrochoc, en réussissant à nous émouvoir, elles renouvellent, chacune à leur manière, un discours dont l’espoir semblait avoir disparu, couvert par les sirènes du fatalisme. Dans La Distance, dystopie futuriste située en 2077, qui figure un échange entre un père resté sur Terre et sa fille, partie sur Mars, Tiago Rodrigues nous rappelle qu’il y a toujours une place pour le dialogue entre les générations, même quand elles semblent trop éloignées pour se comprendre.
Dans Y’a plus qu’à, brillante mise en abîme de la compagnie Scena nostra, une bande de comédiens drôlement désabusés nous montre qu’il est possible de parler d’écologie avec humour, en évitant les sermons et l’éco-anxiété.
« L’intérêt du théâtre est lent, c’est presque un choix de société. Et dans la tachycardie contemporaine et politique, c’est très dur de pouvoir prouver ce qu’on fait, parce que c’est plus long que ça. » proposait il y a quelques jours Eric Ruf, le président sortant de la Comédie Française.
On aurait envie d’être moins modeste. Tandis que plane au-dessus d’elle l’épée de Damoclès du rabotage budgétaire, la culture, et son porte-étendard, le théâtre, parviennent encore à émouvoir et éveiller : un rôle précieux à préserver face aux enjeux de demain.
Alvaro Goldet
La Perle