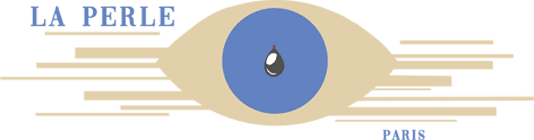L’artiste iranien présente sa première rétrospective au Pavillon du Carré de Baudouin, dans le 20ème arrondissement. Une exposition qui retrace près de 15 années de création, interrogeant les ambiguïtés de l’image.

In dubio pro reo. « Au bénéfice du doute » en latin. C’est le nom de la dernière exposition de l’artiste iranien Pooya Abbasian. Sa première rétrospective à Paris. Celui qui parvient à peindre avec la lumière des images vidéo qu’il capte – des heures durant ou à la volée – aime cultiver l’art du doute. À l’affût des actualités qui secouent le monde et adepte, sans le savoir, de la philosophie du « ma » – philosophie de l’espace vide – Pooya Abbasian ne cesse de casser les frontières, l’œil vif et généreux.
Votre exposition s’intitule « In Dubio Pro Reo », une expression juridique latine. Pourquoi avoir conçu votre première rétrospective comme une « traversée du doute » ?
Depuis longtemps, j’ai cette fascination pour l’expression française « bénéfice du doute ». Quand je l’ai apprise en tant que non-francophone, j’ai tout de suite aimé. Dans mon travail technique au cinéma, il n’y a pas de place pour le doute – tout doit être parfait, hyper technique. Mais dans mon travail artistique, c’est l’inverse : je cherche le doute, le hasard, la poésie. Cette tension était déjà là.
Avec la curatrice Noélie Bernard, on a eu des débats pendant des mois sur le titre. Elle trouvait que l’expression « bénéfice du doute » recouvrait une réalité trop limitée, et que in dubio pro reo comportait la notion de protection nécessaire à la création, il y a aussi la notion de responsabilité, celui répond de ses actions. Pour moi, quand on doute, ça veut dire qu’il y a quelque chose. Si on ne doute pas, il y a un problème dans la création.
L’exposition s’ouvre sur une oeuvre frappante qui indique ces mots : »Laissez venir à moi les petits enfants ». Pourquoi avoir choisi ces mots comme entrée en matière ?
Pooya Abbasian : C’est le lieu qui prend la parole au début de l’exposition. Avec Noélie, on a fait des recherches sur le bâtiment. Avant de devenir un centre d’art, le Carré de Baudouin était un orphelinat. Et il y a encore aujourd’hui, dans le bâtiment d’à côté, un foyer pour enfants en difficulté. À l’entrée, on trouve toujours cette phrase gravée. Avec les scandales de l’Église qui ont éclaté récemment, tout le monde est devenu plus sensible à l’ambiguïté de ces mots.
On a trouvé cette tuile et cette aiguille d’horloge dans les archives du Carré de Baudouin – des objets jetés lors des rénovations, sauvés par chance. L’idée de planter l’aiguille dans la cimaise est assez violente mais elle évoque les traumatismes de ce passé qu’on ne peut pas effacer. Déplacer cette phrase à l’entrée de l’exposition n’est pas seulement un hommage à l’histoire du lieu mais aussi une façon de déplacer les mots, de les considérer comme des images et de leur faire prendre de nouvelles significations – à l’instar du reste de mon travail.

Vous collaborez depuis 2011 avec le cinéaste iranien Jafar Panahi notamment pour son dernier long-métrage, Un simple Accident [Palme d’or à la 78ème édition du Festival de Cannes]. Comment cette expérience nourrit-elle votre rapport à l’image ?
J’ai fait la post-production de tous ses films depuis 2011. Ce travail, c’est de la manipulation pure : on prend quelque chose de réel capturé par la caméra, et on commence à mentir. On coupe des millisecondes, on change les couleurs, on enlève des éléments…
Abbas Kiarostami [ndlr, réalisateur iranien, 1940-2016] disait quelque chose qui m’a marqué : tout ce qu’on fait au cinéma, ce sont des mensonges. Mais en mettant bout à bout ces mensonges, on crée une vérité beaucoup plus grande que la réalité qu’on a essayé de capturer.
Cette manipulation de l’image, cette question de la réception, ça influence inconsciemment mon travail personnel. Dans mes œuvres, j’essaye de me débarrasser de cette consommation de l’image, de la questionner autrement.
Travailler avec Jafar Panahi c’est aussi l’accompagner à braver la censure du régime de Téhéran. Votre œuvre How to be a successful artist from The Middle-East (2025) interroge avec humour la perception de votre art en occident.
En Iran, en 2007 puis 2009, j’avais déjà réalisé deux projets critiquant l’exotisme des artistes du Moyen-Orient – comment ils se représentent et utilisent consciemment et inconsciemment des éléments exotiques pour « plaire » à l’Occident.
En 2011, je suis arrivé en France avec, au départ l’intention de ne rester que quelques mois, notamment pour représenter Jafar Panahi au Festival de Cannes en 2011.
Mais lorsque Mojtaba Mirtahmasb, qui avait co-réalisé le film Ceci n’est pas un film, a été emprisonné à son retour à Téhéran, j’ai prolongé mon séjour en France, jusqu’à décider d’y rester. Et alors je suis devenu moi-même l’objet de cet exotisme en tant qu’artiste iranien immédiatement labellisé. Ce que je critiquais là-bas, j’en devenais l’objet ici.
Et récemment, avec une curatrice irano-suisse, Yasmin Afschar, on a créé comme un « manuel d’instruction » indisponible pour artistes du Moyen-Orient – mais qu’on ne peut jamais ouvrir, il est sous une cloche de verre. On n’a plus besoin de donner le contenu, la couverture suffit.

Votre série Lumen transforme des images de catastrophes (pétrolier Sanchi, sécheresse iranienne…) en impressions spectrales. Vous « esthétisez » la tragédie…
Cette série est née d’une expérimentation sur l’impression de vidéo, quand j’ai réalisé que je voulais imprimer des images vidéo. Je suis obsessionnellement les médias, surtout ce qui se passe en Iran – c’est mon seul lien avec le pays. Et ce lien, c’est catastrophique : toujours des tragédies, des enjeux écologiques, la guerre…
Je prenais ces images et les imprimais sur des papiers photo expirés. L’idée était de voir si avec cette simple transition pouvait changer la nature de l’image car l’image se produit par fraction et se reproduit par réfraction. Le fait de l’imprimer sur un papier expiré, c’est aussi questionner le temps. Il y a le temps de l’image, le temps de la première impression et celui de la réimpression de cette image en disparition, scannée avant qu’elle ne s’évapore.
Je me sentais mal d’apprécier esthétiquement ces images horribles. Il y a cette sensation ambiguë : « Merde, c’est horrible, mais c’est beau, qu’est-ce que je peux faire ? » J’ai voulu travaillé cet endroit, cette sensation de trouble où l’esthétique devient corporelle (Vivian Sobchack, le corps du film).
Vous travaillez de plus en plus avec les plantes, notamment la renouée du Japon. Que représente cette plante dite invasive pour vous ?
La renouée du Japon m’a particulièrement frappé : c’est la première plante qui a poussé après Fukushima. Elle est considérée comme invasive mais elle pousse pour une vraie raison [NDLR : la renouée du Japon a été ajoutée à la liste des espèces végétales exotiques envahissantes, mis en application en août 2025].
Dans un sol hyper pollué, elle arrive à survivre et même à purifier le sol. C’est la nature qui prend le contrôle pour réparer les erreurs humaines. C’est pour ça qu’elle est si invasive : elle prend le contrôle quand elle commence à pousser. C’est vraiment une métaphore de la résistance et de la résilience. Paradoxalement, elle est comestible et utilisée dans la médecine chinoise.
L’exposition présente aussi des vidéos très personnelles, notamment une vidéo de dix heures d’une journée dans la boutique de votre père, à Téhéran, qui fut aussi votre premier atelier…
Ces images, je les ai filmées via FaceTime. Pour la maison de ma grand-mère, c’était une semaine après son décès.
J’ai commencé à regarder ces images pour cette exposition, et j’ai senti qu’il fallait qu’elles passent par quelque chose qui évoque la mémoire – les casser, les fragmenter. C’est comme ça qu’est née cette installation avec la projection qui se brise en passant par des verres mais quand on regarde l’ensemble, ça la reconstruit aussi. C’est exactement comme fonctionne la mémoire.
Apolline Limosino
La Perle
In dubio pro reo de Pooya Abbasian
Du 20 septembre au 13 décembre 2025
Pavillon Carré de Baudouin
121 rue de Ménilmontant 75020 Paris
pavilloncarredebaudouin.fr
Instagram: @carrebaudouin