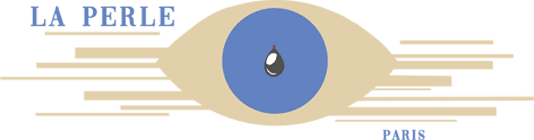Après l’Occupation (Adieu Monsieur Haffmann) et l’après-guerre (Le petit coiffeur), Jean-Philippe Daguerre poursuit sa vibrante exploration de la grande Histoire avec Du Charbon dans les veines et nous plonge à la fin des années 1950, au cœur d’une famille de mineurs du nord de la France.

Entre la fosse, l’élevage des pigeons-voyageurs et les répétitions d’accordéons, les journées de Jean et de son meilleur ami Vlad sont bien réglées. Leurs pères respectifs, Sosthène et Bartek, un immigré polonais, ont passé leur vie à creuser à plus de 500 mètres pour que leurs fils n’aient pas à le faire.
Mais ces derniers n’ont rien voulu entendre. Après leurs études, ils sont revenus à la mine pour faire comme leurs pères. Bientôt, l’arrivée dans l’orchestre de Leila, talentueuse musicienne d’origine marocaine, vient bouleverser leur équilibre.
Avec Du Charbon dans les veines, Jean-Philippe Daguerre met en scène la vie d’une famille ouvrière à la fin des années 1950, dans le bassin minier du nord de la France. La pièce, qui a raflé 5 statuettes aux derniers Molière, est de retour depuis le 6 septembre à l’affiche du Théâtre du Palais-Royal.
Au coeur d'un environnement déchiré
La pluie, le gros ciel et le charbon. Du Germinal d’Émile Zola aux Corons de Pierre Bachelet, l’univers de la mine fascine les auteurs et nourrit notre imaginaire. C’est donc là que Jean-Philippe Daguerre a choisi d’installer cette nouvelle fable.
Fable parce qu’à la différence du célèbre écrivain du XIXème siècle, le metteur en scène évite la dureté naturaliste. Sans rien gommer des préjugés racistes et de la violence sociale qui rongent la France de l’époque, il tisse avant tout une puissante histoire d’amour et d’amitié. C’est d’ailleurs ce que Daguerre maîtrise le mieux (ses précédentes pièces le prouvent) : l’art d’inventer des récits humains au cœur d’un environnement déchiré.

C’est un très beau travail de mise en scène qui vient souligner ce contraste. Il y a le gris sur gris des costumes de Virginie H. Mais aussi l’éclairage de Moïse Hill, qui offre un large empire aux ombres. Elles se logent où elles peuvent, dans les coins de la lumière. Rappelant cette fine pellicule de charbon qui se dépose sur la vie des mineurs, leurs vêtements, leurs fruits, leurs poumons.
Partout en somme, sauf autour de cette étroite table de cuisine en bois où s’organise toute la vie de la famille. C’est ici, que Sosthène et Bartek refont le monde, que Jean et Vlad répètent leur partition, que Simone et son mari se retrouvent à deux, que tous se réunissent pour regarder l’équipe de France en coupe du monde de football.
Des airs de Jean Gabin
C’est autour de cette table que se révèlent les caractères hauts en couleurs de la famille. Ils sont portés par une extraordinaire troupe de comédiens qui gagnent en justesse au fil de dates. On rit avec le vieux Sosthène aux poumons condamnés par la silicose.
Un bout en train joyeux, qui philosophe avec des mots simples, interprété à la perfection par Jean-Jacques Vanier, en alternance avec Didier Brice. Quant à Aladin Reibel (en alternance avec Christian Mulot), son Bartek a des airs de Jean Gabin, avec sa nature puissante et ronchonne d’où perce une immanquable gentillesse.

Et l’accent ch’timi de Simone, jouée par Raphaëlle Cambray, en alternance avec Sophie Artur, achève de donner vie au petit logement ouvrier. Vraie fille de mineur, Raphaëlle Cambray a inspiré Jean-Philippe Daguerre dans son écriture. Elle lui a partagé ses souvenirs d’enfance. Ce dernier joue d’ailleurs dans sa propre pièce. Il partage le rôle d’un médecin ange gardien et fanatique de jazz avec Philippe Maymat.
Dans ce quotidien monochrome, il y a aussi la musique que Jean et Vlad pratiquent à leurs heures perdues avec Leila. On est, à chaque fois, cueilli par la charmante et désuète sonorité de l’accordéon. Théo Dusoulié, Julien Ratel, et Juliette Behar, respectivement en alternance avec Basil Alaïmalaïs, Arnaud Dupont et Yasmine Haller ou Garance Bocobza, ont suivi une formation de musicien où sont passés par l’école de comédie musicale.
Cette « valsette », la même qu’ils répètent tout au long de la pièce, vient raviver leur vie comme elle éclaire le spectacle. Sans verser dans le difficile genre de la comédie musicale, l’auteur fait de la musique un élément clef.
Jean-Philippe Daguerre joue une fois de plus sur la corde sensible du rire et de l’émotion avec ce magnifique portrait des corons. Il donne à voir des hommes et femmes devenus frères et sœurs dans le ventre de la Terre. Comme dirait Sosthène et Simone, à la mine « Il n’y a plus de bicots, il n’y a plus de cathos, il y’a juste des gueules noires ».
Alvaro Goldet
En partenariat avec le Théâtre du Palais-Royal
La Perle
Du charbon dans les veines de Jean-Philippe Daguerre
À partir du 6 septembre 2025
Théâtre du Palais-Royal
38, rue de Montpensier, 75001 Paris
www.théâtredupalais-royal.fr
Instagram : @thpalaisroyal