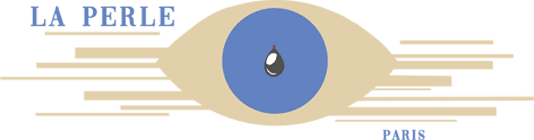La 79ème édition du festival d’Avignon bat son plein. De la programmation du IN à celle du OFF, plus de 1800 spectacles sont programmés dans la cité des Papes. Notre sélection des spectacles à suivre

"Colette, chambre 212" : Judith Desse danse le grand âge
Le repas, la toilette, la prise des médicaments, ce sont tous les rituels rythmant l’ordinaire des Ehpad que la chorégraphe Judith Desse et sa partenaire, la danseuse polonaise Katharine Stankiewicz, portent sur les planches.
Une prouesse chorégraphique époustouflante, dont toute la technicité réside non pas dans le mouvement mais dans son économie, un immobilisme en crispations et tremblements, dont émane poésie et souffrance.
Derrière le masque d’argile qui couvre le corps vieux et rouillé de Colette, on peine à croire que se cache celui d’une femme de 35 ans. Dans une autre vie, Judith Desse était infirmière et a côtoyé de près le grand âge et l’univers des Ehpad. Elle continue à s’occuper de personnes âgées toutes les deux semaines. Son spectacle est un plaidoyer politique, qui dénonce par le geste les mauvais traitements à l’égard des personnes âgées résidentes, mais également les conditions de travail déplorables dans lesquelles les soignants n’ont d’autres choix que d’exercer. Une pièce actuelle, qui redonne corps à ceux qu’on ne veut pas voir.

« Colette, chambre 212 », au théâtre l’Entrepôt jusqu’au 26 juillet (relâche le 22 juillet).
"Nourrir l’humanité c’est un métier" : la puissance du théâtre documentaire
Charles Culot, comédien et co-créateur de la pièce, est fils d’agriculteur. Un jour, au cours d’un échange avec un paysan, une phrase l’interpelle : « entre les citadins et les ruraux, on ne se connait plus ». S’ensuit une enquête longue et fouillée, au plus près des professionnels de la terre, ces hommes et femmes des campagnes qui nourrissent la population. De là est né un spectacle, documentaire donc.
En mettant en scène des paroles véritables récoltées auprès de plus de 60 agriculteurs et jalonnées d’archives vidéo, la pièce traite de la difficile réalité paysanne et soulève des questions universelles sur les écarts de richesse, l’accaparement des ressources ou la monétarisation de la nature, avec une question de fond : demain, comment nourrir l’humanité ?
Création de la compagnie belge Adoc, la pièce exploite au mieux le genre du théâtre documentaire. Rien ne dépasse de cette proposition, que l’engagement de Charles Culot et sa partenaire, Valérie Giménez (en alternance avec Pauline Moureau), ne fait que rendre plus intense. Une objet théâtral percutant et instructif qui a le pouvoir de nous indigner.

« Nourrir l’humanité c’est un métier », au théâtre du Train Bleu jusqu’au 26 juillet.
"Wasted" : le brio de la la jeune compagnie Méchant Méchant
C’est l’histoire de Ted, Charlotte et Dan qui fêtent l’anniversaire de leur meilleur ami, Tony, décédé il y a 10 ans. L’occasion d’un bilan. Qu’ont-ils fait depuis ? Que sont-ils devenus ? Ont-ils réalisé leurs rêves de gosses ? Le constat est sans appel. Sur le papier, on pourrait se dire : encore une histoire de jeunes adultes en crise existentielle.
Sauf. Sauf que le texte, de l’auteur britannique Kae Tempest, datant de 2013, est d’une implacable fraîcheur. Que les 3 comédiens, issus de l’ESCA, jouent remarquablement bien, basculant de l’humour à la gravité avec aisance. Et qu’ils ont eu la bonne idée de se faire accompagner pendant tout le spectacle par Raphaël Mars, multi instrumentistes et chanteur lyrique, qu’on peut apercevoir au fond de la scène, douché d’une légère lumière blanche.
Tout cela donne un drame plein d’humour, qui parle de jeunes adultes confrontés à la difficulté de vivre. C’est maîtrisé, brillant et drôle.

« Wasted » au théâtre 11, jusqu’au 26 juillet.
"Quatre mains" : initiation au miracle de la musique classique.
Alice et Elios ne s’était pas vus depuis le conservatoire, il y’a 30 ans. Ils sont réunis par Jean, l’autre membre de leur inséparable trio d’adolescence, qui n’apparait pas, pour jouer la fantaisie en fa mineur de Schubert, une oeuvre à quatre mains dont ils n’étaient jamais allés au bout.
Second volet, après Les imposteurs (2018), d’un cycle de Jean Boillot et Alexandre Koutchevksy conçu « pour et avec » la jeunesse, Quatre main entremêle fiction et récit autobiographique dans une histoire d’amitié, où il est également question de souvenirs, d’éducation musicale douloureuse et de rêves déchus.
L’exquise élocution d’Elios Noël, l’élégance délicate d’Aline Le Berre, à eux deux, ils forment un duo idéal pour nous guider à travers cette pièce épurée, où toute l’attention est laissée au texte et aux mélodies. C’est une initiation au miracle de la musique classique, dont les comédiens, malins, ne vont nous livrer tout au long de la pièce que de courtes bribes, jusqu’au moment tant attendu… la répétition finale.

« Quatre mains », au théâtre 11, jusqu’au 26 juillet.
"Derrière" ou l'art d'habiller le vide.
« Rien, ce n’est pas rien ! ». La phrase de Raymond Devos résume bien le travail engagé par Nicolas Chaigneau et Claire Laureau, fondateurs de la compagnie pjpp, depuis plusieurs années. Leur pari est culotté : créer de la matière théâtrale à partir de situations à priori sans intérêt. Avec Derrière, les deux comédiens réinvestissent le théâtre 11 d’Avignon, lieu de leur premier succès, et poursuivent avec brio leur exploration de mise en présence du vide.
Tout débute par un solo de danse, du moins une tentative. Sans décors ni artifices, Nicolas et Claire s’avancent. Lui esquisse, l’air pénétré et résolu, les premières arabesques de sa partition. Elle, tente tant bien que mal d’y faire coïncider la bande son. La situation est cocasse. Mais très vite la scène déraille, s’enlise, échoue. Comme toutes celles qui lui succèderont. A moins qu’avec ceux là, l’échec n’ait le goût de la réussite…
Misant sur un playback corporel réjouissant, Nicolas Chaigneau et Claire Laureau s’amusent à manipuler la banalité de l’instant pour en suggérer la part d’absurdité, de poésie et de drôlerie. Comiques par leur gestuelle, attachants par leur maladresse, l’un comme l’autre brillent dans l’art de la suggestion. Entrainant avec douceur le public dans ce grand numéro d’illusion, Derrière est une invitation à décentrer notre attention. Regarder aux frontières de l’invisible, là où l’imaginaire relaye la narration. Une pièce inclassable qui a le bon ton de désintellectualiser le théâtre, avec intelligence et dérision.
« Derrière », au théâtre 11, jusqu’au 24 juillet.
-"Rossignol à la langue pourrie" : notre patrimoine linguistique.
Nourrie depuis son adolescence par les textes de Jehan Rictus, poète parisien des années 1900, la comédienne Agathe Quelquejay rêvait de s’en faire l’interprète. Grâce au metteur en scène Guy-Pierre Couleau, c’est chose faite. Plus que bien faite.
Un rossignol. Une langue pourrie. L’oxymore suffit à plonger dans le cœur vibrant des textes de celui qui bouleversa la poésie de son époque. À rebours de ses contemporains, Jehan Rictus fit en effet du petit peuple au langage gouailleur et argotique sa principale source d’inspiration. Un hommage à ceux et celles que la vie a tenu à l’écart, ballotés par la misère sociale, invisibilisés par l’indifférence crasse du monde.
Eclairée par un croissant de bougies à la flamme vacillante, Agathe Quelquejay leur offre de nouveau une voix, portant à l’attention du public une tranche oubliée de notre patrimoine linguistique. Avec une justesse éblouissante, la comédienne exhume cette langue populaire à l’identité forte qui porte en elle le poids des souffrances si longtemps tues. Une pièce au charme désuet qui parlera à ceux qui veulent bien l’entendre.
« Rossignol à la langue pourrie », au théâtre du Balcon, jusqu’au 26 juillet (relâche le 24).
"Frantz" mime, la troupe bruite, le public savoure.
C’est un bric à brac digne d’une droguerie aux rayonnages ultra fournis. Gaine de plomberie par-ci, couverts par-là, bidon d’eau, bâches de peinture, râpe à fromage, ventouse, dans Frantz, la créativité est dans le détournement d’objets. Avec ces cinq comédiens, grand cru 2019 de l’école internationale de théâtre Jacques Lecoq, préparez-vous à entendre le bruit des vagues dans le bruissement d’un sac poubelle.
Trop rarement porté au plateau, l’art du mime et du bruitage retrouve ici tout son pouvoir magique. La mécanique est aussi simple qu’audacieuse : Paul Ménage, mime à la précision horlogère, incarne Frantz, jeune cadre au quotidien morne et routinier. Quand son père décède, tout explose. Derrière lui ses quatre acolytes, l’un narrateur, les autres bruiteurs et chanteurs, accompagnent alors sa quête existentielle d’un habillage sonore aussi ludique qu’imaginatif.
Petit bijou d’inventivité, Frantz fait de la scène un espace d’émerveillement où la sensorialité se substitue aux mots pour narrer. D’onomatopées en bruitages savamment recherchés, l’histoire surgit, s’étoffe, captive. Une hybridation entre théâtre et dessin animé qui a le chic de s’adresser à ceux qui aiment imaginer, des enfants aux personnes âgées.

« Frantz » au théâtre de la Scala Provence, jusqu’au 27 juillet (relâche le 21).
"La Faille" : une jeunesse qui résiste.
Solee est une animalie (entendre « anomalie »), une jeune fille à fleur de sensibilité, une des rares à continuer de s’émouvoir dans un monde où les humains ont perdu la faculté d’éprouver. Pour cela, elle risque l’enfermement. La Faille est un récit dystopique aux accents de fin du monde : des villes se sont effondrées, les ressources ont été épuisées, une faille cisaille peu à peu les sols, engloutissant derrière elle les vestiges d’une société désaxée. Mais Solee a soif de liberté : malgré les inquiétudes de sa mère, elle décide de partir. Et d’exister.
Commande spéciale du metteur en scène Paul Pascot (La prochaine fois que tu mordras la poussière) à l’auteur belge Serge Kribus, La Faille déboule à Avignon sans avoir jamais été représentée. Une dystopie théâtrale parmi tant d’autres ? Loin s’en faut.

Inventant un langage à part entière, misant sur une écriture aussi poétique qu’atypique, Serge Kribus réussit à allier la forme et le fond pour questionner la perspective de l’effondrement du vivant dans sa globalité. Dans ce road trip initiatique, Mélissa Merlo et Léo Nivot sont stupéfiants : avec une candeur déroutante, les deux comédiens livrent une partition urgente, fiévreuse : celle de la jeunesse qui se sait concernée. La très belle mise en scène de Paul Pascot, réhaussée d’une bande son remarquable, finit de les sublimer.
Jamais moralisateur, loin de tout catastrophisme, le texte embrasse les interrogations de notre temps, en toute humilité. Quand les applaudissements retentissent, l’émotion affleure, l’espoir résiste. Une question demeure : au point de bascule, en guise d’ultime salut, que restera-t-il si ce n’est notre capacité à nous émouvoir ?
"Coin Operated" : le numéro fou de Jonas et Lander

les machines sont à l’arrêt mais que le public hésite encore à se lever pour remettre un jeton
"Radio Live" : la guerre sous la peau
Depuis dix ans, le projet Radio Live donne voix à des jeunes venus du monde entier. Ce nouvel opus en trois volets présenté au Festival d’Avignon, met en lumière des existences bouleversées par la guerre.
Comme dans une émission radio, Oksana, Hala et Ines, qui ont connu le conflit, en Ukraine, en Syrie ou en Bosnie, répondent aux question d’Aurélie Charon, créatrice de la pièce. Une puissante impression de vérité se dégage de ces témoignages qui ne sont pas écrits, et qui changent, de quelques mots, chaque soir.
Les 3 femmes nous parlent ainsi de leur vie, leur pays, leur famille ébranlés par la guerre, qui ne nous a jamais semblé si intime. Aurélie Charon use de tout son savoir faire acquis depuis 15 ans en tant que productrice à France Culture pour tisser une scénographie riche et soignée.
Elle porte ces témoignages en les ponctue d’images tournées lors de leur voyage en commun à Sarajevo, mais aussi d’interviews de leurs proches restés dans leurs pays d’origine. Enfin, il y a Emma Prat, installée sur un côté de la scène et qui élève cette enquête par des interludes musicaux d’une rare émotion.

"Mami" : l'hommage de Mario Banushi à la mère
Lors de la cérémonie d’ouverture du Festival d’Avignon, Tiago Rodrigues le présentait comme un « prodige ». Le jour de la première, Mario Banushi s’est montré à la hauteur de nos espoirs.
Dans Mami, il compose un hommage à la figure maternelle, inspiré de sa mère, mais aussi de toutes les femmes qui ont traversé sa vie. Il est élevé par sa grand-mère en Albanie jusqu’à ses 13 ans avant de rejoindre sa mère à Athènes, où il vit avec elle au dessus de la boulangerie où elle travaille.

Avec cette troisième pièce, le jeune metteur en scène de 26 ans reste fidèle à son théâtre sans parole. Une économie de langage qui conserve toute notre attention au reste. La lumière, le décor et les corps …Ce langage qui ne connait aucune frontière. Dans une lenteur éthérée, plusieurs tableaux se succèdent : l’accouchement, les noces ou la toilette de la vieille mère aidée par son fils.
Mario Banushi peint l’amour maternel et filial et sa résistance au temps dans des scènes entre ombres et lumières qui renvoient aux toiles contrastées d’un Caravage ou d’un Rembrandt. Malgré les corps qui s’usent, ce qui unit les personnages ne dépérit jamais. Une oeuvre d’art à l’état pur.
Alvaro Goldet et Amandine Violé
La Perle