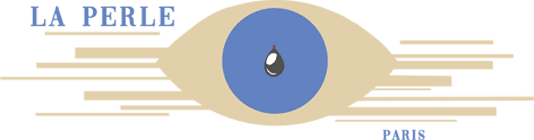Réduisant l’artiste britannique à son image de « peintre optimiste », La Fondation Louis Vuitton passe à côté d’une partie de l’oeuvre de David Hockney dans une rétrospective démesurée mais qui manque parfois de profondeur. La faute au manque d’humilité dont est coutumière l’institution.

Bernard Arnault a la plus grande. La plus grande exposition de David Hockney jamais présentée. Jusqu’au 31 août, le peintre britannique de 87 ans occupe les 11 salles de la Fondation Louis Vuitton – propriété du milliardaire français – avec plus de 400 œuvres. L’argument ne manque pas d’être répété, y compris par l’artiste lui-même (né en 1937): « Cette exposition est particulièrement importante pour moi, car c’est la plus grande que j’ai jamais eue ». Mais que révèle cette démesure ? Plus précisément, que dit-elle des motivations de ceux qui en portent le projet ?
Dans les deux premières salles, consacrées aux décennies 1950 à 1980, quelques belles découvertes, parmi lesquelles un portrait du père de l’artiste (1955) ou We Two Boys Together Clinging (1961), hommage discret à l’œuvre du poète homosexuel Walt Whitman. On découvre des débuts emprunts de surréalisme et d’expressionisme, une touche hâtive, un goût pour la poésie et l’expérimentation. Dans Boy about to take a shower (1964) le style se clarifie, devient plus épuré et annonce les iconiques piscines et les lofts ensoleillés de la Californie.
La suite de l’exposition – l’essentiel donc – se concentre sur une période allant des années 2000 à aujourd’hui. Des grands formats, des dessins, des aquarelles, mais surtout des œuvres « peintes » sur Ipad. Les paysages du Yorkshire et de la Normandie occupent une place quasi exclusive, tout comme les portraits, que l’on retrouve en quantité et dont une soixantaine sont ameutés au coude à coude dans la même salle.
Oser l'optimisme
Ce que l’on voit, c’est un Hockney qui s’assagit, dans ses thèmes comme dans son style ; qui sait aussi rester de son temps et se saisir des outils numériques pour continuer de peindre, avec toujours la même intensité. C’est d’ailleurs peut-être là le vrai sujet de l’exposition : cette fraîcheur intacte et cette curiosité jamais entamée pour le monde, aussi bien que pour les moyens contemporains de le représenter. Dommage que cela se trouve trop hâtivement réduit à l’argument dérisoire de l’optimisme.
« David Hockney est l’un de mes artistes préférés, confie Bernard Arnault dans son avant-propos au catalogue. Parce qu’aussi en se rapprochant de lui, on se rapproche de tous ceux qui se reconnaissent en lui. Il rend optimiste. »
Et Suzanne Pagé, la directrice artistique de la fondation, d’abonder : « L’œuvre de Hockney, très populaire, le sera encore aujourd’hui (…) Hockney devient un vecteur de bonheur dès qu’il tient un pinceau, un crayon, une tablette, alors même que l’homme traverse des tragédies. » Ce n’est donc qu’à cela que servent tant d’efforts : plaire à tout le monde ? Si tel est l’objectif, disons qu’il est atteint : on sort ravi.

Le mieux et l'ennemi du bien
Pourtant, on est loin de la rétrospective de 2017 au Centre Pompidou. Plus modeste (une centaine d’œuvres), elle restituait pourtant plus finement le parcours de cette figure de l’art contemporain, notamment du courant pop. Elle était également plus riche en termes de médium et de documents, avec un corpus élargi de photographies, d’ouvrages et de gravures. Moins grande, donc, mais avec plus d’ampleur historique et esthétique, offrant une compréhension plus approfondie des évolutions de l’artiste.
Reconnaissons que l’exposition de la Fondation Louis Vuitton évite l’écueil de la redite. Elle offre au contraire une agréable suite à celle du Centre Pompidou, un chapitre plus resserré, plus sensible également. La salle des paysages normands, avec ses murs sombres et son accrochage all-over, saisit par son envergure et l’éclat des couleurs, parfaitement mis en valeur.
Mais le mieux est l’ennemi du bien, et c’est précisément cette mise en scène qui confère parfois au projet un regrettable effet show-room. Remplir un mur de dix mètres de long, cela épate toujours la galerie. Seulement, les œuvres finissent par décorer.

A bigger show, et après ?
Ce n’est pas la première fois que la Fondation Louis Vuitton joue la carte du « Bigger Show« . Ce fut le cas l’an dernier avec l’exposition Mark Rothko, qui réunissait près de 115 peintures. L’événement se présentait comme la première rétrospective de l’artiste américain en France… depuis la précédente (!) en 1999, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (dont Suzanne Pagé était alors directrice). Ceux qui adorent étaient comblés, les autres ressortaient un peu essorés par l’interminable déclinaison du même.
Mais alors que retenir de ces parti pris ? Qu’ils flattent. Le public tout d’abord, qui se trouve rassasié. La Fondation, ensuite, qui peut s’enorgueillir de son artillerie lourde. Personne ne doutait des moyens financiers de l’institution (qui s’appuie sur le groupe LVMH, leader mondial du luxe), ni de la capacité de l’art à transformer le capital économique en capital symbolique.
Soyons optimistes à notre tour, il y a bien sûr de la générosité dans ces expositions XXL. Ce qui gêne, c’est quand transparaît le manque d’humilité dont elles procèdent également. Cela donne des expositions certes bien montées, mais souvent trop sages, trop triomphantes et surtout trop satisfaites d’elles-mêmes. On ne le dira jamais assez : ce n’est pas la taille qui compte.
Thibault Bissirier
La Perle
Exposition « David Hockney 25 »
Du 09 avril au 31 août 2025
Fondation Louis Vui tton
8, avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, Paris
www.fondationlouisvuitton.fr
Instagram : @fondationlv